
Enjeu de cette programmation : les épousailles de la magnifique collection privée réunie par Karmitz et du fonds imposant du musée qui l’accueille. Quant au film, il consiste à écouter Marin Karmitz parler de ses choix, expliquer ce qui l’attache à quelques-uns des tirages accrochés en ces lieux.

Toute une société, où chacun tient son rôle comme il imagine qu’il se doit de le faire, y conspire à cacher une vérité très tôt découverte dans le récit. Comme venus d’un autre monde, l’arrivée inopinée des services sociaux de l’Etat, appelés à l’aide par le jeune homme, relancera pour quelque temps une intrigue qui a tendance à tourner en rond.
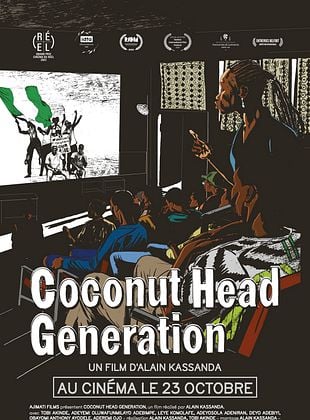
Ce documentaire possède l’élégance de plans silencieux, respirations ou signaux d’alertes adressés au spectateur.

Claudia Marschal crée une archive parlante, rythmée par le cliquetis du clavier de l’adjudant, peuplée d’images (Super 8, téléphone portable, plans fixes…) revisitant le trauma.

Tahar Rahim incarne de manière fascinante le chanteur dans le biopic de Mehdi Idir et Grand Corps Malade.

Le film, modeste, a une réelle vertu pédagogique : sans rien montrer, il ramène le corps féminin (son poids, ses organes, ses traumas et ses larmes) dans le champ. Enfin, il finit par être le portrait de quatre femmes qui se tiennent discrètement comme à côté du monde.

Le scénario devait être aussi crédible que respectueux. En filigrane, le film interroge le rapport à la terre et aux pratiques agroalimentaires. Qui est le sauvage, celui qui vit en pagne ou celui qui arrive avec son engin pour couper les arbres et déloger les habitants ? On devine la réponse, mais le suspense est bien entretenu.
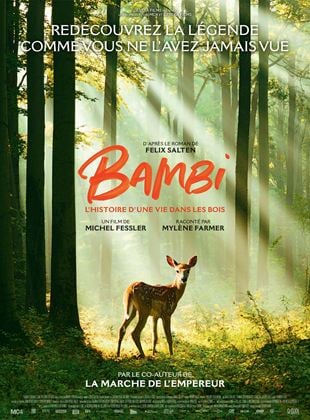
Il est heureux de voir un film pour enfants faire aujourd’hui le pari d’une expérience de cinéma très simple, qui aura, aussi pour les adultes, quelque chose d’apaisant.
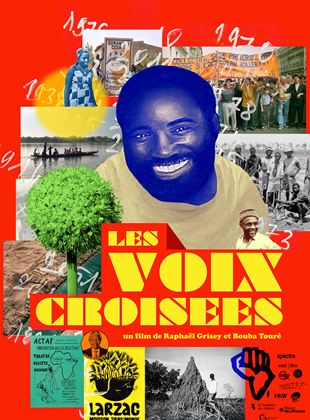
On respire, dans le documentaire de Raphaël Grisey et Bouba Touré Les Voies croisées. Le récit est libre, polyphonique, porté par le désir d’inscrire un projet d’agriculture vivrière, en Afrique de l’Ouest, dans une vaste réflexion politique.

Le réalisateur situe le récit de ce mélodrame minimaliste dans les années 1990, à une époque où la question de l’art et de la représentation était encore taboue dans la société. A voir.

Premier long-métrage de Hassan Guerrar, attaché de presse connu comme le loup blanc dans le milieu du cinéma, ce film dévoile avec pudeur un pan douloureux d’intimité de l’incroyable vie de ce gavroche franco-algérien.

Il est difficile de ne pas fondre devant cette profusion sensible qui semble émaner d’une masculinité à l’ancienne, bagarreuse et désordonnée, en cours de déconstruction.

Alain Guiraudie opère ici une greffe inouïe entre la tragédie et le burlesque, entre la gravité du scénario criminel et la banalité des corps qui l’incarnent, entre le poids de la culpabilité et la trivialité des élans quotidiens.

Le film est aussi un bel hommage à tous ces artistes – et ils sont nombreux – qui ont sacrifié leur vie (mais aussi dans son cas celle des autres) à leur passion. Un monument aux artistes inconnus.

La deuxième partie de cette copieuse biographie suit le combat de l’acteur contre la maladie, et son engagement pour rendre visibles les personnes handicapées.

En cela, par l’exceptionnalité de la situation filmée, Les Docteurs de Nietzsche se distingue du projet de la mise à nu politique d’une institution telle que le concevaient les films de Depardon.

C’est au récit d’une aliénation féminine et d’une libération des griffes d’une phallocratie violemment imbécile que nous invite ce récit, qui ne fait pas le détail dans la description de genre.

La belle idée du réalisateur Chris Sanders (L’Appel de la forêt, Dragons) consiste à créer de l’émotion à partir de la batterie, figurée par des traits lumineux qui semblent couler comme le sang dans les veines. De ce motif récurrent procède un récit d’urgence – l’épuisement de la charge – où l’indépendance sensible de Roz s’avère être un moyen de survie.

