
Conçu comme un outil de réflexion et de pédagogie, le documentaire de Laurent Metterie a le mérite de mettre en lumière le fossé qui sépare les époques, le chemin parcouru, les mutations qui se sont produites dans la tête des petits mâles, hommes de demain différents de ceux d’hier. Et de fournir un document susceptible de nourrir les discussions entre générations.

Dumb Money s’éloigne non seulement pour cette raison de son modèle inavoué – l’excellent, cruel et délirant Casse du siècle (2015), d’Adam McKay, avec Christian Bale et Steve Carell – mais ne lui arrive à la cheville dans aucun des secteurs requis pour la réussite d’un film.

Les Filles vont bien cherche les instants de grâce et réussit parfois à les trouver : il n’y aura pas de drame, c’est moins vendeur, ce qui en dit long de notre attente de noirceurs et de coups durs, faute desquels un film ne mériterait pas le déplacement.

Il n’empêche, Perfect Days donne une impression de déjà-vu. Tant le sujet que le dispositif nous rappelle le somptueux Paterson (2016), de Jim Jarmusch, avec Adam Driver dans le rôle d’un chauffeur de bus, auteur et poète à ses heures.

C’est ce moment décisif, libératoire, que François Caillat décide de faire évoquer à Edouard Louis, comme au débotté, tout en le filmant dans les rues désertes des lieux qui en furent le théâtre (à Amiens), en une sorte de longue remontée sensible.

Entre une succession d’assassinats riches d’inventivité grotesque et la recherche de l’identité du tueur, Eli Roth multiplie les signes divers d’une Amérique contemporaine et de son passé, jusqu’au gag et au lapsus sanglant. A ne pas manquer.

L’idée la plus troublante de Conann consiste à retracer les mues successives de la guerrière féroce, depuis ses 15 ans jusqu’à son dernier jour, à travers six actrices imprimant génialement leur marque. Chaque étape de la vie de Conann ressemble à une mort. « Tuer sa propre jeunesse, tel est le comble de la barbarie. » Un Chef-d’œuvre.

Alors que l’on craint une approche purement illustrative, le mélodrame se révèle plus retors. Certes, il y a les fétiches de l’après-guerre : le dancing de Châteauroux, les GI, les chewing-gums… Mais le film fait passer en sous-main des questions plus modernes qui exacerbent sa dimension réflexive (...).
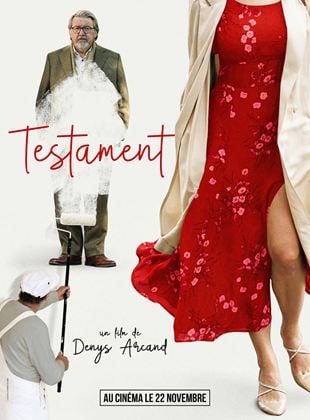
Le cinéaste ne se montre jamais à la hauteur des débats qu’il soulève, la profondeur analytique de ses saillies pouvant se résumer à un désespéré « On ne peut plus rien dire », tandis que femmes et jeunesse sont filmées comme des monstres irrationnels.

L’humour recherché à chaque réplique donne le sentiment d’assister à un one-man-show. La réalisation paresseuse qui l’accompagne fait, hélas, l’impasse sur le cinéma.

Mêlant dossier de société, ressorts pathétiques et abattage actoral, voici un premier long-métrage au ton « nakachetolédanien » (on pense plus particulièrement à Hors normes, 2014) dont le goût du spectacle eût gagné à être tempéré.

Alors la glace fond, donnant lieu à quelques scènes presque fantastiques, comme si le bonheur ne pouvait se vivre qu’en rêve. Un parti pris intéressant, installant une mélancolie à basse tension.
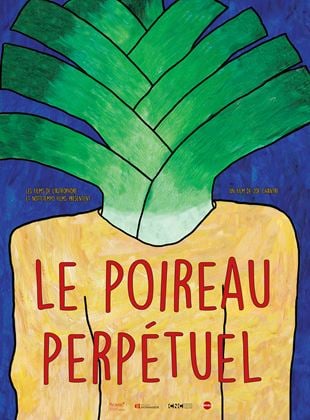
On saute d’un événement à un autre : un rêve raconté face caméra, un dessin, un voyage au Vietnam avec sa mère ayant refusé la chimiothérapie, un désir d’enfant auquel il faut renoncer. Et le journal d’effectuer sans cesse un mouvement de balancier : la vie vient toujours contrebalancer la mort, toutes deux sont des affaires qui ne peuvent se traiter séparément.

Le film revisite le transfuge de classe à travers ce personnage mutant, qui ne crie jamais victoire et se sent prêt à observer la chute (en amour, en travail) comme une donnée en soi, potentiellement inévitable. Cette lucidité installe une haute tension, empêchant ce film léché de se regarder sur papier glacé.
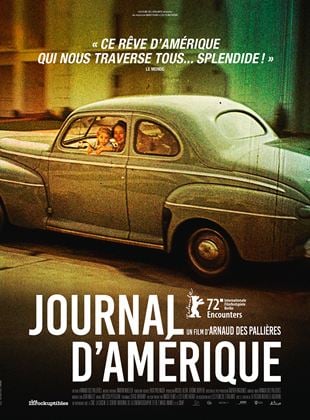
La puissance d’envoûtement du Journal d’Amérique, sélectionné à la Berlinale (Encounters), tient déjà à son rythme, lequel consiste à égrener des microrécits dans des cartons, comme on jetterait des cartes sur la table, le spectateur se trouvant pris dans un engrenage.

Rien à perdre ne tranche pas, refuse d’élaborer un discours normatif sur le bien-être de l’enfant… Cette approche détaillée rend le film aussi pertinent qu’exaltant.

Si Mars Express emporte d’emblée la conviction quant au monde interconnecté qu’il nous présente, c’est parce qu’il ne cherche aucunement à le justifier, mais le montre directement en train de fonctionner, gourmand en notations modernistes qui s’accompagnent toujours d’une trouvaille plastique.

Dominique Marchais part à la recherche de l’invisible, filme les gestes d’experts prélevant des indices sous la surface (de l’eau, des sols), et c’est dans l’infrapaysage qu’opère cette œuvre en eau douce et radicale.

Ouvert sur un tableau de la barbarie révolutionnaire, clos sur un Napoléon défait et mythomane – il ment sur ses faits d’armes aux enfants de ses geôliers à Sainte-Hélène –, le film ne craint pas de faire, entre ces deux points, s’affronter des camps qui parlent la même langue (l’anglais), ce qui ne laisse pas d’être troublant.
