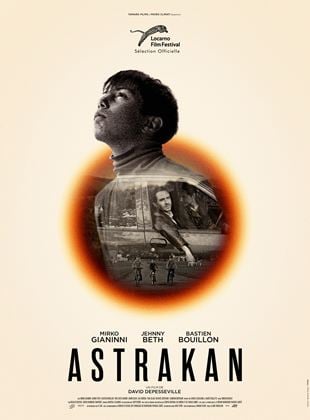Adapté d’un spectacle qui avait dû s’interrompre pendant la deuxième pandémie, Lucie perd son cheval travaille la question de la panne : si le film peut (ou cherche à) désarçonner, c’est pour mieux sonder, avec sa formidable actrice (Lucie Debay), le vertige de la création.

Pour la France met en scène cette confrontation, sans virer à la charge, mais en décrivant un champ complexe de forces et tensions, lié à l’histoire de l’immigration, comme à la blessure des identités.

On tient dans ce pitch une des vertus du cinéma de Lacheau, comparé au tout-venant verbeux de la comédie populaire française, qui consiste en une accumulation des aléas confinant au non-sens, voire au pur burlesque.

Comme Rohmer, Philippe Petit aborde sans grandiloquence son enjeu, observant si un idéal se dissout dans le magma des désillusions ordinaires ou s’il lui résiste.

A 56 ans, ce réalisateur n’aime rien tant que l’expérimentation et la provocation. Dans La Tour, pas l’ombre d’une vedette, et un genre, l’horreur, auquel il ne s’était encore jamais frotté. A ne pas manquer.
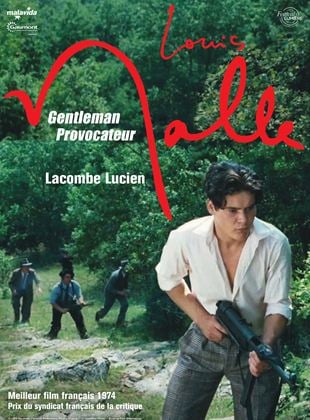
Voilà un grand film français. Un film qui ne doit rien à la mode, à l'intellectualisme de telle ou telle coterie. Un film puissant et déchirant, qui plonge ses racines dans un drame que beaucoup ont vécu et dont les remous n'ont pas fini de nous secouer. Un film d'une maturité intellectuelle et d'une maîtrise technique exemplaires. Un film dont on sort remué, bouleversé, angoissé. Bref un chef d'oeuvre, mot galvaudé, mais pour une fois exact.

La volonté de filmer autrement et sans pathos le travail du deuil et « la vie qui revient » est un contrepied qui n’a malheureusement plus grand-chose d’original.

Ce qui s’annonce comme un film d’espionnage brûlant tourne au plaidoyer féministe à usage interne et à la leçon de morale patriotique.

Un joli conte graphique sur l’exil, où les légendes se mêlent au réel, où la chevelure noire des femmes dessine autant la nuit qu’une route vers la liberté.

Dans sa simplicité, le dispositif n’est pas sans rappeler Délits flagrants (1994), de Raymond Depardon. Ici, la caméra capte une montagne de travail invisible qui aboutira parfois, mais pas toujours, à une décision de justice heureuse.

Le récit introduit de la nuance, va dans les zones d’ombre, avec un personnage de soldat libanais collaborant avec Israël, ce qui aura des conséquences malheureuses pour ses proches. Un sombre mélodrame, sans concession.

Emaillé de dialogues sarcastiques et truffé d’autodérision, ce buddy movie réussit subtilement à contourner toutes les scènes obligatoires du genre pour capter le spleen du fantôme particulièrement sensible.

L’esthétique emprunte au naïf, au surréalisme, lorsque les ailes se fondent dans des pétales de fleurs, ou que l’on se perd dans le bleu d’un papillon. Dans leur quête de beauté, les deux réalisatrices sud-coréennes nous emmènent dans des territoires insoupçonnés.