
AlloCiné : au moment de la préparation de "L'Horloger de Saint-Paul", vous souhaitiez déjà faire un film sur l'Occupation. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette période ?
Bertrand Tavernier : Cela fait longtemps que je pensais à un film sur cette période. Je voulais trouver un sujet qui ne recoupe pas les oeuvres importantes qui ont déjà été faites sur l'Occupation, que ce soit La Traversee de Paris, Lacombe Lucien voire même Le Chagrin et la Pitie, dans un autre genre. L'un des premiers scénarios que j'avais commencé à écrire était consacré à Bonny et Laffont qui faisaient partie de la Gestapo française. Mais c'est Pierre Bost qui m'en a découragé. Il m'avait dit : "Même si on essaie d'être dur avec eux, le film va les rendre intéressants alors que ce sont de telles crapules."
Ensuite, j'ai essayé de travailler avec Jean Aurenche sur un ou deux sujets mais cela n'a jamais abouti, parfois par la faute de comédiens. Nous avions même trouvé une bonne idée inspirée par le journaliste Alain Riou, auteur d'un livre d'entretiens avec Aurenche. Je trouvais formidable ce que m'avait raconté Jean Aurenche sur cette période. Je rêvais de l'incorporer à un film. Pendant un long moment je n'ai pas trouvé comment faire jusqu'à ce que je rencontre Jean Devaivre et qu'il évoque la manière dont il avait vécu cette période. Je me suis alors dit que je pouvais mélanger leurs expériences.
Je suis fasciné par l'Occupation car c'est une période où les choix se posaient de manière dramatique et quotidienne. Rien n'était théorique. On était ou on glissait du bon ou du mauvais côté, quelquefois par inadvertance, par choix personnel ou par lâcheté. C'est intéressant de parler de cela, surtout à notre époque.
Samuel Fuller vous disait : "pour faire un film, il faut être en colère". Est-ce le cas pour ce film ?
La phrase de Fuller est vraie. Il faut être en colère, mais pas seulement : il faut savoir aimer, admirer, respecter les gens. On ne peut pas passer trois ans de sa vie avec des personnages en étant en colère avec eux. J'adorais parler avec Aurenche ou Devaivre car ils m'apprenaient des choses qui me faisaient rire, me touchaient ou me mettaient en colère.
Mais c'est vrai qu'il ne faut jamais sous-estimer l'indignation. Il y a certains films qui sont résignés, voire "tièdasses". Moi je n'ai pas envie de faire du cinéma qui soit comme cela. J'ai envie de faire du cinéma qui bouscule. Les Québécois ont un très beau mot sur mes films : "ce sont des oeuvres qui brassent la cage". Je trouve cette expression sublime. Pour faire des films "qui brassent la cage", il faut de l'indignation, mais aussi pas mal d'amour.
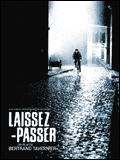
Votre film a un budget de 104 millions de francs. Quelles ont été les difficultés de financement ?
C'est un projet coûteux qui a demandé des constructions de décors, du spectacle... En plus, on sait qu'une partie du public est un peu réticente devant les films historiques. Ils pensent que cela ne les concerne pas. Or moi je pense que ce qui se passe dans Laissez-passer concerne tout le monde. Le passé est excitant à recréer dramatiquement. Les émotions de Laissez-passer sont des émotions du présent. L'humour du film est en prise avec l'époque mais aussi avec aujourd'hui.
Il y a une inculture de plus en plus grande du public. Mais je pense que le rôle de cinéaste et d'écrivain est de se battre contre cela. A chaque fois que j'ai fait un film historique, c'était une bataille pour l'imposer. Pour La Vie et rien d'autre ou Que la fete commence, on a livré de vraies batailles qu'on a remportées. Il n'est pas facile de convaincre des gens de financer ces projets. Je dois beaucoup à Alain Sarde qui m'a soutenu.
Les deux personnages principaux de "Laissez-passer" réagissent de manière différente face à l'Occupation. Vous êtes-vous posé la question sur quelle aurait été votre manière de réagir ?
Je pensais à cela à chaque plan. Qu'est-ce que j'aurais fait ? Parfois j'espérais avoir réagi comme Devaivre même si les 300 km en vélo ou le dynamitage d'une locomotive m'aurait posé problème. Là j'aurais été plutôt comme Aurenche.
Je voulais montrer qu'il y avait plusieurs formes de résistances, plusieurs manières de se comporter pour ne pas se déshonorer. Je n'ai pas cessé de penser à ma façon de réagir et je n'ai pas de réponse. Je n'aimerais par revivre cette époque pour pouvoir répondre à cette question.
Pierre Bost lance dans "Laissez-passer" : "Après tout nous ne sommes que des faiseurs d'histoires". C'est cela, pour vous, le rôle d'un réalisateur ou d'un scénariste ?
Pierre Bost dit "faiseurs d'histoires" de manière modeste et immense. Un faiseur d'histoire est quelqu'un qui laisse place aux rêves, à l'imagination. Le premier art est de savoir conter une histoire. Quand j'ai commencé ce film, mon ami José Giovanni m'a dit : "J'espère que tu ne vas pas montrer que le cinéma était quelque chose de dérisoire par rapport à d'autres activités. Tu serais alors totalement coupé de la réalité. Le cinéma, cela nous a permis de tenir le coup, cela nous a réchauffé."
Aurenche raconte qu'à la sortie du Mariage de chiffon, Paul Eluard a couru pour le féliciter lui disant que son scénario était sublime. Aurenche m'a alors dit que c'était peut-être parce qu'on voit dans le film un officier français se comporter avec élégance à un moment où l'armée française avait donné un spectacle pitoyable.
Faiseur d'histoires, dans la bouche de Bost, cela paraît petit, modeste mais Zola et Hugo étaient aussi des faiseurs d'histoires. Un faiseur d'histoires est capable de prononcer le mot "résistance" comme le faisait remarquer Jean-Luc Godard pour Les Dames du bois de Boulogne. Il est capable d'exalter l'amour de Charles Vanel et Madeleine Renaud dans Le Ciel est à nous.
Exigence et talent dans une époque de lâcheté sont aussi une forme de résistance.
Comment avez-vous choisi les acteurs ?
Denis Podalydès, cela a été très rapide. J'avais besoin de quelqu'un de vif, intelligent, rapide, dont on puisse penser, avant même qu'il ait un stylo dans la main, qu'il peut écrire des dialogues brillants. Je suis très content car j'ai montré le film au fils de Jean Aurenche qui m'a dit : "J'ai cru voir Jean tout le temps sur l'écran. Vous l'avez capturé, y compris dans ses travers."Devaivre, c'était différent. J'ai pris un acteur qui ne lui ressemblait pas. Physiquement. Je trouve que Jacques Gamblin, que je considère comme un acteur génial, à su traduire l'engagement irraisonné de Devaivre. Pour lui, quand on est occupé, il faut être contre l'occupant. Il n'y a pas de temps à perdre à raisonner. En plus, Gamblin avait l'air d'être dans l'époque. J'avais l'impression d'avoir un comédien contemporain de ces années-là.
Ceci a été également le cas pour les actrices. Je voulais retravailler avec des comédiennes que j'avais déjà dirigée mais leur donner des rôles très différents. Je voulais donner à Maria Pitarresi, qui était dans Ca commence aujourd'hui, un rôle plus tendre. Quant à Marie Gillain, à qui j'avais fait faire des choses épouvantables dans L' Appât, je voulais exploiter son charme et ses talents de comédie. Ce serait une merveilleuse actrice pour une comédie américaine : elle est à la fois sexy, drôle et vive et dégage un charme immédiat. Charlotte Kady était femme-flic dans L 627 : c'était bien de la voir dans des robes. En plus je trouve qu'elle a le talent comique de gens comme Suzy Delair, Arletty ou Danielle Darrieux. Quant à Marie Desgranges, c'est une révélation. Elle sait chercher l'émotion.
Il y a un point commun entre toutes ces femmes : elles remettent à chaque fois en question les hommes avec qui elles sont et, à chaque fois, elles ont raison. J'aimais bien l'idée d'avoir deux personnages qui se débattaient autour de quatre femmes fortes.
Propos recueillis par Marie-Claude Harrer

(Et voir notre article )
et cinq extraits du film (, , , , )
canal
